MADANIYA
De l’utilité de certaines rumeurs en
temps de guerre
Roger Naba'a
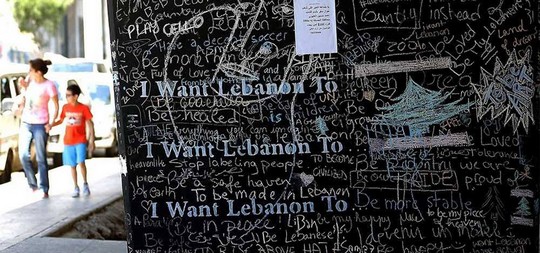
Mardi 25 septembre 2018
Paul Vieille in
Memoriam (1)
Article paru dans
la Revue des peuples Méditerranéens,
numéro spécial sur le thème «villes
tourmentées», n0 37, 1986, pp. 51-56 que
www.madaniya.info reproduit à l’occasion
de la parution du dossier Liban: less
racines américaines de la guerre du
Liban».
Adieu Beyrouth
Sujet immense qu’on
ne pourra appréhender dans toute son
extension ni toute sa compréhension. Une
indication de recherche et de lecture,
néanmoins, autour d’une hypothèse: dans
la guerre du Liban (1975/…).
La rumeur est une continuation de la
guerre (civile/confessionnelle), par
d’autres moyens.
Mais dans le vaste
genre des rumeurs engendrées par la
guerre du Liban (ou les guerres du
Liban), seule «est une continuation de
la guerre», une espèce, dont la logique
et la raison guerrière sont celles de la
guerre du Liban elle-même, qui
s’inscrivent et servent sa stratégie.
Deux impasses ont
façonné la guerre du Liban.
-
Une impasse militaire,
l’impossibilité de conduire la
guerre à son terme «naturel»:
«occuper le territoire de
l’adversaire et détruire les forces
de l’ennemi», mener «une bataille
décisive» qui porte sur son «centre
de gravité» afin de conclure la
guerre par la victoire», et
l’impossibilité de ne pas faire la
guerre, avec des armes modernes,
aviation et nucléaire exclus.
-
Une impasse politique,
l’impossibilité de penser un projet,
une «grande politique» ailleurs que
dans l’horizon du confessionnel, et
l’impossibilité de ne pas faire une
politique. Double impasse, mais en
fait une seule. Comment néanmoins
faire accepter à l’autre les
conditions qu’on veut lui imposer ?
La conclusion
militaire de la guerre étant
irréalisable, l’alliance politique –ou
un compromis historique– impensable, les
confessions du Liban, pour tenter de
réaliser leurs objectifs, allaient
recourir à d’autres moyens: la «terreur
aveugle» pour la guerre militaire, et la
rumeur qui la porte et la continue pour
la «guerre psychologique».
Moyens au service
d’une stratégie négative, ils furent eux
aussi négatifs. Militairement négatifs.
On dirait que dans cette guerre le
régime confessionnel a cédé à ses
fantasmes et ne s’épouvante plus quand
il «réalise» son ultime conséquence:
anéantir dans le désordre des morts et
des ruines l’ensemble des signes par
lesquels peut se (re)constituer la vie
sociétale de l’autre, entraîner en lui
quelque chose qui serait comme la «mort
du social», le contraindre à éprouver
sur son territoire-même, et dans notre
cas dans la ville/Beyrouth, la terreur
de sentir que quelque chose
d’indispensable à son être lui échappe:
à faire l’expérience de l’impossibilité
d’y vivre.
Signifiant occupant
la place de tout signifié militaire dans
cette stratégie de destruction, cette
politique de déni de l’autre, cette
terreur, est aveugle sans l’être.
Destinée à faire le plus de victimes
possibles, le plus de ruines possibles,
elle est aveugle, elle frappe sans
discernement, elle tue au hasard.
Pilonnages,
bombardements, attentats à la voiture
piégée, plasticages, tueries collectives
sur base confessionnelle, tireurs
embusqués, assassinats individuels, ne
choisissent pas leurs victimes, tout un
chacun est visé. Elle frappe à
l’aveugle. Elle veut frapper à
l’aveugle. Elle enveloppe la ville d’une
géographie de la mort. Ces pilonnages et
autres bombardements qui charrient on ne
sait quel torrent spectral, font que le
ciel de la ville change de taille,
d’orientation. Il est ce par quoi ça
arrive. Il devient une zone de soucis,
et provisoirement la seule. Où se
planquer ? Comment passer, par où, quand
?
Dans un geste plein
de haine, les attentats aveugles
marquent la ville dont les sens sont
entièrement pervertis, brouillés par les
zones de peur et d’inquiétude, de mort
et de ruine qui circulent au hasard des
chutes et des explosions dans une ville
où ça se décompose. Elle veut frapper à
l’aveugle, fait de l’entièreté du
territoire de l’autre et de sa société
«civile» son seul objectif, et prouve la
possibilité d’y faire surgir la mort en
n’importe quel point, n’importe quand,
n’importe comment.
Elle veut
«déterritorialiser» l’autre par
éclatement interne de son territoire et
dislocation de sa société. Des gestes
comme envoyer ses enfants à l’école,
aller faire son marché, aller au travail
se font et se défont au gré de cette
terreur, maintenant que tous les repères
de la ville ont disparu et que le temps
en suspens est subjugué par cette
fureur.
Si dans la guerre
du Liban, la terreur aveugle vise la
ruine physique du territoire de l’autre,
la rumeur, cette rumeur-là en réalise la
ruine imaginaire, par le moyen du
langage. «En outre, s’il est honteux de
ne pouvoir se défendre avec son corps,
il serait absurde qu’il n’y eût point de
honte à ne le pouvoir faire avec la
parole dont l’usage est plus propre à
l’homme que celui du corps», Aristote,
Rhétorique, 1355b/38, «L’homme doit
pouvoir se défendre par la Parole».
Guerre et rumeur,
l’une à l’autre liées, sont deux
tactiques. Dans les deux cas il s’agit
de ruiner, mais point par les mêmes
moyens. Et il est arrivé que la rumeur
puisse être une arme aussi puissante et
efficace que la terreur aveugle.
«Parole oblique,
puissante et souple, pleine de ruses et
de tactiques inattendues, la rumeur est
surtout terriblement efficace, qui court
sur toutes les lèvres, très vite, et
porte avec elle bien plus la force des
émotions que l’information des mots…
Elle n’existe que d’être un emballement
répété de l’imaginaire social», Lydia
Flem, «Bouche bavarde et oreille
curieuse», Le Genre humain, 5, Paris
1982.
Dans le cas de la
guerre du Liban, métaphore de la terreur
aveugle, cette parole oblique
enveloppera la ville d’une atmosphère
empoisonnée :
«Sammamu jawou-l-madina, disent les gens
de Beyrouth (Ils empoisonnent
l’atmosphère de la ville). Elle atteint
l’autre dans ce qui en fait un être
sociétal. Qu’elles soient rumeurs d’une
offensive imminente, de la reprise des
combats ou des bombardements
systématiques – rumeurs toujours datées,
prévoyant le moindre détail du scénario,
et toujours le pire –; ou rumeurs d’une
vague de voiture piégées «en liberté
dans la ville»; qu’elles soient rumeurs
de banditisme, de vols à mains armées,
d’enlèvements, de vengeances sanglantes,
ou de représailles; ou bien encore,
qu’elles soient rumeurs de crise
économique, de montée ou de baisse du
dollar… quelles qu’elles soient, rumeurs
de certitude, elles installent l’espace
où elles se propagent dans l’insécurité
et l’anxiété de l’insécurité.
Elles font craindre
aux gens une chose, un événement, une
situation ou son évolution en
catastrophe, indéfinissable bien que
toujours défini, prévu, que rien ne
démentira quand bien même ce qui serait
prévu n’a pas eu lieu. L’échéance est
reportée, la rumeur rebondit sur
elle-même et suspend la ruine,
l’exécution de la menace, à une échéance
incalculable.
Car dans cette
ville «loquace et péripatéticienne»
(Francisco Umbral, parlant de Rome),
bonne conductrice, ville des media par
excellence, que la rumeur de tout temps
a entourée, investie, étourdie et
portée, bouleversée par dix ans de
guerre et la fin de toutes les
certitudes, sauf de celle-ci qui dit que
dans cette ville la rumeur finit
toujours par avoir raison, qu’elle finit
toujours par se réaliser ou réaliser une
de ses sœurs en rumeur. Tout peut
arriver parce que tout arrive.
La physionomie de
la ville en sera parfois bouleversée. Sa
physionomie physique, son tissu urbain.
Les dispositifs militaires de protection
et de contrôle s’en trouveront
renouvelés, renforcés et multipliés,
barrant ses rues et ses quartiers,
quadrillant la ville, découpant son
espace en interdit et permis, dangereux
et praticable. Les barricades et les
murs de sable s’érigent partout. Le
front s’établit à l’intérieur même de la
ville.
Sa physionomie
morale
Ces rumeurs-là
distillent le sentiment d’insécurité,
induisent des comportements de peur,
d’angoisse, une panique perfide, un
rejet de la ville, maintiennent une
menace jamais démentie, polymorphe, qui
diffuse dans la tête des gens la
certitude d’un risque quotidien et
individuel, qui les pousse à rompre ces
rapports insaisissables, profondément
irrationnels qui lient affectivement les
gens à leur lieu de séjour, les gens de
Beyrouth à leur ville où il devient
impossible de vivre (comme dit la
rumeur).
Un exemple parmi
tant d’autres (2)
En 1983, un peu
avant, peut-être aux lendemains des
élections d’Amine Gemayel à la
présidence de la République, une rumeur
ancienne mais toujours recommencée,
s’empara de la ville, ville deux fois
vaincue et désarmée (par l’armée
d’Israël, en septembre 1982, par l’armée
libanaise (?) fin 1982. Beyrouth était
en rumeur: «Il paraît qu’ils mobilisent
et se préparent à ouvrir la ville encore
une fois»; «En fait, ils mobilisent déjà
et se préparent sérieusement à
l’offensive»; «L’offensive est
maintenant imminente» … disaient les
sources bien informées.
Beyrouth était
cette rumeur effarée et confuse, mais
précise et détaillée, elle savait tout
et tout ce qu’elle savait, elle le
savait de source sûre. Elle connaissait
la date de l’invasion, son plan de
bataille, ses lieux de débarquement, son
scénario dans le détail, son
déroulement, ses conséquences, ses
résultats.
Rumeur récurrente,
qui inventait à l’infini des rumeurs et
créait une situation hallucinatoire où
la réalité ne cessait de multiplier ses
déformations au miroir de la rumeur,
situation au sein de laquelle la ville a
(sur)vécu avec une peur insurmontable,
elle-même récurrente. Il y avait alors,
en Beyrouth, quelque chose d’impalpable
qui était comme l’idée de départ,
c’est-à-dire de leur fuite. Certains
sont effectivement partis, quittant
provisoirement ce lieu devenu
inhabitable; d’autres envisageaient la
chose sérieusement, en prévision du
pire; d’autres encore se préparaient à
l’idée de partir et de quitter la ville.
Départs réels des
uns, partiels de certains, imaginaires
de certains autres ceux qui parlaient
avec envie du départ des autres, cette
rumeur en marche avait fini par
pervertir le sens des rapports à leur
ville des gens de Beyrouth qui n’étaient
plus, pour ceux qui étaient restés, que
le lieu de l’incertitude où l’on n’ose
plus se risquer que rapidement et pour
des besoins indispensables. Un lieu où
l’on survit quand on ne le quitte pas.
À sa manière qui
maintient une puissance de confusion et
de désordre, qui maintient l’espace de
la ville dans la peur, au service d’une
stratégie de dislocation, cette
rumeur-là dit ce que dit la guerre; elle
dit que Beyrouth est (devenue)
impossible à vivre. Certains magasins
ferment, certains commerces
disparaissent, certaines maisons
s’éteignent, certains espaces meurent.
Si ces rumeurs-là
favorisent les fantasmes des uns et des
autres, souvent complémentaires dans
leurs contradictions, elles ne les
créent pas. Elles offrent un espace de
cristallisation. Plus que des
informations elle laisse parler et
exaspérer des émotions refoulées. Car
ces rumeurs relatent la guerre. Elles
lui fournissent entre deux
conflagrations l’attribut de la
continuité. Elles sont une «continuation
de la guerre»: il y a quelque chose qui
peut passer de l’une à l’autre (le
fantasme de) la mort de Beyrouth.
Pour aller plus
loin sur ce thème du même auteur:
https://www.renenaba.com/esquisse-d-une-reflexion-sur-la-question-de-la-fragmentation-des-societes/
Note
-
Cet article s’inscrit dans le cadre
d’un travail en cours sur Beyrouth.
-
A tour de rôle, selon les
circonstances et le territoire où
elle prend, la rumeur concernera
tout le monde. Tous {chrétiens et
musulmans, la droite et la gauche,
les Syriens et les Palestiniens, les
gens d’en bas, comme ceux d’en
haut), tous donc ont participé à la
vie des rumeurs, tour à tour
victimes ou propagateurs, dans des
rapports inextricables. D’autres
exemples sont possibles.
Illustration
 Le
dossier Liban
Le
dossier Liban
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

