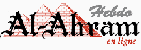|
Présidentielles françaises . Le deuxième tour opposant Sarkozy à Royal s’annonce serré. Que peuvent espérer les pays arabes qui sont dans la crainte d’un changement d’une politique qui leur a été favorable depuis De Gaulle ? Etat des lieux.
Au lendemain du premier tour des présidentielles, les Français semblaient plus proches d’une nouvelle image de leur pays. Le nouveau locataire du palais de l’Elysée les préoccupe certes, mais le tracas se sent plus dans le monde arabe qui a décidé de ne pas être indifférent au dossier de la politique étrangère de la France, bien que celui-ci ne soit un sujet prioritaire dans la campagne électorale. Cette préoccupation arabe s’est traduite par une visite de trois figures importantes à Paris : le président Moubarak, Abdallah II de Jordanie et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbass. C’était certes des visites d’adieu à celui que l’on nomme le dernier gaulliste, mais une mission de reconnaissance aussi. Ils tentaient de savoir si le départ de Jacques Chirac marquera la fin d’une tradition diplomatique française instaurée depuis une quarantaine d’années. C’est depuis 1967 en particulier que l’on a vu ce véritable virage politique français. Le général De Gaulle, au déclenchement de la crise qui s’est terminée par l’agression israélienne du 5 juin 1967, avait mis en garde les responsables israéliens : en aucun cas ceux-ci ne doivent « tirer en premier ». Dès le 2 juin, dans le contexte de tension montante, la France annonce qu’à partir du 5, elle cessera toute livraison de matériel militaire aux belligérants, donc à Israël. Auparavant, la France était le principal fournisseur d’armes à Israël. De Gaulle a une phrase qui suscitera un tollé en Israël qui a voulu l’assimiler à de l’antisémitisme. Il a dit d’Israël que c’était un « peuple d’élite, sûr de lui-même, et dominateur ». Depuis, c’est une évolution régulière bien précise sous Chirac (lire page 5). Mais aujourd’hui peut-on tabler sur l’histoire pour lire l’avenir ? Des craintes se manifestent dans un monde arabe. Inquiétudes légitimes. Ségo comme Sarko n’ont pas hésité à courtiser Israël, même si c’est avec une grande précaution : éviter par exemple de se prononcer sur le conflit arabo-israélien, alors qu’il s’agit d’une affaire stratégique pour la France. Trop risqué à leurs yeux lorsqu’on arrive au décompte des votes. Les tendances de l’un ou de l’autre sont cependant présentes, parfois encore contradictoires pour ne pas dire schizophrènes. Il faudrait une relecture de leurs différents discours pour retrouver cette hésitation de vouloir maintenir les liens avec les Arabes, mais sans s’impliquer directement dans le conflit arabo-israélien. Fini des mots comme « la politique arabe de la France doit être une dimension essentielle de sa politique étrangère … La priorité de la politique arabe de la France et de l’Europe, c’est naturellement, aujourd’hui, la construction de la paix au Proche-Orient », comme le déclarait Chirac au Caire il y a 11 ans. Doutes sur Sarkozy Somme toute, Nicolas Sarkozy demeure le moins pro-arabe. Le timbre à son effigie, avec « bonne chance », lancé par la poste israélienne, n’est qu’un simple élément de son « pro-israélisme confirmé », dit-on. Il serait d’ailleurs le néo-conservateur de France. N’a-t-il pas dit à Washington, l’an dernier : « J’aimerais dire à quel point je me sens proche d’Israël ». Durant les émeutes des banlieues en 2005, Sarko, alors ministre de l’Intérieur, a fait appel au ministre israélien de la Sécurité publique, Gideon Ezra, et au commissaire Moshe Karadi pour le conseiller sur l’affaire ... « Il s’est également affiché comme un supporter d’Israël, même s’il a jugé, par exemple, la riposte militaire contre le Liban disproportionnée. Néanmoins, il estimait que cette réaction était légitime dans ses fondements », a déclaré Pascal Boniface, directeur de l’Institut français des relations internationales et stratégiques au quotidien d’Oran. De toute façon, les termes employés, même s’ils peuvent contenir des critiques pour Israël, sont plus incriminants à l’égard des Palestiniens : « A nos amis palestiniens, je veux dire que l’existence et la sécurité de l’Etat d’Israël ne sont pas négociables et que rien ne peut justifier la violence. Les terroristes qui prétendent agir en leur nom et pour leur bien sont en fait les véritables ennemis des Palestiniens, car ils les privent d’une paix à laquelle ils aspirent et ont droit … Nous devons cette même franchise à nos amis israéliens. La poursuite d’une politique de faits accomplis sur le terrain est contraire aux intérêts d’Israël à long terme », a-t-il dit. Cette attitude un peu floue a poussé Sarkozy à assurer Moubarak de la continuité de la politique française au Proche-Orient s’il était élu, lorsqu’il s’est entretenu avec lui à Paris. « J’ai dit au président Moubarak que si j’étais élu président de la République, je souhaiterais avoir avec lui les mêmes rapports confiants et amicaux qu’il entretient avec le président Chirac », a dit le candidat du parti UMP (au pouvoir). Un autre aspect qui entre en jeu c’est celui de l’immigration. Au-delà de son ‘aspect franco-français, la question de l’immigration s’affirme désormais comme une question de politique intérieure de plus en plus forte, étant donné son lien même flou ou distendu avec le monde arabe. « Un retour du refoulé arabe dans la conscience française et des effets démultipliés sur la politique arabe de la France », souligne Gilles Kepel, spécialiste français de l’islam contemporain. Entre autres indices, pour la première fois depuis la période coloniale, l’armée française s’interroge sur la présence massive de musulmans en son sein. Craignant une pression communautaire, elle a chargé l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) d’une enquête sur « les militaires français issus de l’immigration ». « Leur loyauté est sans cesse questionnée », note Christophe Bertossi, responsable du programme immigration à l’Ifri, auteur du rapport avec la sociologue Catherine Whitol de Wenden. A cet égard, selon Azouz Begag, ministre démissionnaire de l’Egalité des chances, le système politique français républicain a toujours fonctionné sur un paradoxe : d’un côté, il ne reconnaît que des citoyens détachés de toute appartenance culturelle, religieuse ou ethnique ; de l’autre, il ne cesse d’instrumentaliser les identités à des fins électorales et partisanes. Les Français d’origine maghrébine et africaine sont peu représentés dans les institutions politiques, en particulier au Parlement (Assemblée nationale et Sénat), a-t-il soutenu. Begag est connu pour ses péripéties avec Sarkozy. Quoi qu’il en soit, certaines réactions du candidat ont eu une connotation bien raciste : « racaille », qui avait enflammé les banlieues de France en 2005, ou encore « carcheres », lorsqu’il évoquait le nettoyage des cités habitées en grande partie par des populations immigrées. Un aspect qui pèserait un peu sur sa politique arabe en général. Ségolène indécise ? Quant à Ségolène Royal, elle avait déjà rencontré Moubarak en décembre lors d’une précédente visite de ce dernier à Paris. Celle-ci est souvent jugée comme beaucoup moins experte en matière de politique étrangère. Selon Boniface, « elle a envoyé — elle aussi — des signaux contradictoires (…) Comme si elle ne voulait plus prendre le risque de s’aventurer sur ce terrain. On peut dire qu’elle a été finalement soumise à une sorte de chantage qui a payé : la polémique largement gonflée de sa visite à Beyrouth l’a certainement poussée à adopter un profil bas lors de son passage à Jérusalem ». Elle avait rencontré un député du Hezbollah avant d’aller voir Ehud Olmert. Une offense pour les Israéliens, mais un des principaux conseillers de Ségo n’est que le député socialiste Julien Dray, dont le frère est médecin au sein de l’armée israélienne. D’ailleurs, en réponse à une question sur la participation d’entreprises françaises (Alstom et Veolia) à l’installation de lignes de tramway reliant des colonies, elle a affirmé : « On ne peut pas considérer que les coopérations économiques entre les entreprises françaises et Israël, en l’occurrence l’exploitation d’une ligne de tramway en construction à laquelle vous faites allusion, soient destinées à renforcer ou à légitimer les colonies israéliennes dans les Territoires occupés. Le sort de ces colonies devra être décidé entre les deux parties lors des négociations pour une paix définitive et la création d’un Etat palestinien ». Cela dit, elle a trouvé les moyens de s’attirer la foudre des néo-conservateurs américains. Deux principaux Think Tanks néo-conservateurs des Etats-Unis ont brutalement attaqué la candidate, alors qu’ils ont fait un éloge tout aussi inexplicable de Sarko après le voyage de ce dernier à Washington en septembre 2006 (9), un vibrant hommage au futur candidat « pro-américain », porteur d’une nouvelle politique étrangère française « indépendante de la ligne gaulliste traditionnelle ». Sally McNamara, au Margaret Thatcher Center for Freedom, relevant que « c’est un secret de polichinelle que Sarkozy avait critiqué l’opposition de Chirac à la guerre en Iraq en 2003 », que « la position de Sarkozy sur la guerre israélo-libanaise représentait une autre rupture avec la politique étrangère française » et que « les Etats-Unis pourraient avoir (en cas de victoire de Sarkozy) un partenaire plus amical en Europe et au sein du Conseil de sécurité de l’Onu » ... L’American Enterprise Institute avait lui aussi salué le pro-américanisme de Nicolas Sarkozy ... L’énigme vient par contre du sort beaucoup plus clément réservé à Nicolas Sarkozy (par ses mêmes Think Tanks néo-conservateurs) ... Nile Gardiner, le « patron » de Sally McNamara, croit lui aussi en Nicolas Sarkozy et affirme que « l’ascendant de Sarkozy est considéré comme très positif par Washington ». Nile Gardiner est lui-même très engagé dans cette idée d’expansion de l’Otan et l’idée d’une adhésion d’Israël à l’organisation ... La majorité des 26 membres de l’Otan, et en premier lieu la France, est opposée à ce que Israël devienne membre à part entière de l’Alliance Atlantique. On le voit bien, même si cette dimension de politique étrangère ou politique en particulier paraît plus ou moins estompée ; elle ne manque pas de susciter des intérêts, voire des préoccupations chez les uns (les Arabes) et des espoirs chez les autres (Américains et Israéliens). Il est sûr qu’en dépit du fait que la participation française au processus de paix ne se conçoit plus désormais que dans le cadre de l’Union européenne, avec contribution de celle-ci au « quartet » accompagnant les pourparlers (effectifs ou suspendus) entre les partenaires du conflit israélo-palestinien, les uns et les autres misent toujours sur un rôle distinctif d’une France qui a toujours cherché une politique répondant à ses choix, même à l’heure de la mondialisation effrénée.
Droits de reproduction et de diffusion réservés. © AL-AHRAM Hebdo Publié avec l'aimable autorisation de AL-AHRAM Hebdo |
|
|
Source : Al-Ahram hebdo http://hebdo.ahram.org.eg/... |
Avertissement
Palestine - Solidarité a pour vocation la diffusion
d'informations relatives aux événements du Moyen-Orient.
L' auteur du site travaille à la plus grande objectivité et au respect des opinions
de chacun, soucieux de corriger les erreurs qui lui seraient signalées.
Les opinions exprimées dans les articles n'engagent que la responsabilité
de leur auteur et/ou de leur traducteur. En aucun cas Palestine -
Solidarité ne saurait être
tenue responsable des propos tenus dans les analyses, témoignages et
messages postés par des tierces personnes.
D'autre part, beaucoup d'informations émanant de sources externes, ou
faisant lien vers des sites dont elle n'a pas la gestion, Palestine -
Solidarité n'assume
aucunement la responsabilité quant à l'information contenue dans ces
sites.