Chronique
Sous les charmes de l'esclavage
Chérif Abdedaïm
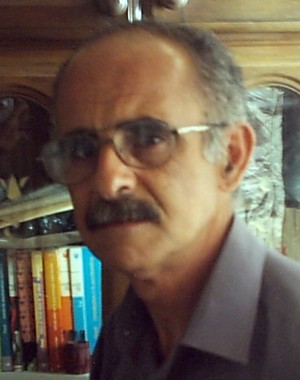
© Chérif
Abdedaïm
Lundi 12 mai 2014
Toutes les grandes révolutions se sont
faites contre le pouvoir absolu,
arbitraire et tyrannique. Toutes se sont
faites au nom de la dignité de l’homme,
que des puissances despotiques
bafouaient.
Tous les grands documents déclarant les
droits de l’homme sont le fruit d’une
prise de conscience progressive de la
dignité inaliénable de tous les hommes
et tous, cependant, sont nés au prix de
beaucoup de souffrances et de beaucoup
de larmes.
Ainsi, l’histoire moderne a connu le
despotisme éclairé. Le despote
prétendait avoir le privilège de jouir
des lumières de la Raison, inaccessibles
au commun des mortels. Sa volonté était
la source de la loi. Son pouvoir était
absolu : il n’avait point de compte à
rendre au peuple.
Héritières misérables de ces despotismes
sont certaines dictatures dérisoires qui
fleurissent à l’époque contemporaine.
Elles règnent par la terreur simple, la
corruption, la concentration de tous les
pouvoirs, le cynisme et la brutalité.
Despotisme précaire que celui-ci,
puisqu’il peut à tout moment être
renversé.
Le despotisme survit aussi dans les
régimes autoritaires. Dans ceux-ci, le «
despote » — concrètement : un individu
ou une minorité — a la hantise de sa
sécurité face à un ennemi désigné.
Quelques havres de liberté subsistent
parfois dans la vie économique, plus
rarement dans la vie intellectuelle et
culturelle, mais il est interdit
d’exprimer une quelconque opposition
politique. Le régime autoritaire
favorise l’hypocrisie : dans votre for
intérieur, vous pouvez penser ce que
vous voulez ; il suffit de ne pas être
opposant, d’avoir l’échine souple. Bref,
ce qui est requis c’est la soumission
extérieure.
Dictatoriaux ou autoritaires, ces
régimes despotiques ne s’embarrassent
guère de constructions idéologiques
compliquées pour se justifier. Pourvu
qu’ils aient la force, qu’ils ne
regardent pas aux moyens, qu’ils
n’hésitent pas à recourir à la violence,
qu’ils aient une police efficace, ils
n’ont guère besoin de se fabriquer des
légitimations. Toute coquetterie
idéologique est ici pratiquement
superflue.
Au XXe siècle, le totalitarisme a poussé
le despotisme classique — dictatorial ou
autoritaire — à son point
d’incandescence. Ce qui n’était que
despotisme minable ou artisanal, et donc
souvent éphémère, cède la place à un
despotisme d’un professionnalisme haut
de gamme.
Les trois premiers totalitarismes du XXe
siècle — communisme, fascisme, nazisme —
ont dès à présent pris place au panthéon
des classiques de la perversité. Bien
sûr, on recueille les recettes du passé
: abus de pouvoir en tout genre,
violence, goulags, terreur, répression,
suspicion, corruption, etc. Quelque
chose de plus est cependant ajouté. Non
un simple ingrédient supplémentaire,
mais quelque chose d’essentiel.
Le totalitarisme résulte du funeste
concours, de la convergence entre la
tendance quasi générale à accepter
volontairement la servitude et l’offre
de produits idéologiques du meilleur
effet « domesticateur ». La dictature,
l’autoritarisme : on les supporte, on
s’y oppose ; le cas échéant, on
s’insurge contre eux. Le totalitarisme,
lui, anesthésie le moi, subjugue les
corps, colonise les esprits et fait
scintiller les charmes de l’esclavage
consenti. L’idéologie est la drogue qui
tue la capacité de discerner le vrai du
faux, le bien du mal, et qui inocule un
substitut de vérité, habituellement sous
forme d’utopie.
 Article publié sur
La Nouvelle République
Article publié sur
La Nouvelle République
Reçu
de l'auteur pour publication
 Le sommaire de Chérif Abdedaïm
Le sommaire de Chérif Abdedaïm
 Les dernières mises à jour
Les dernières mises à jour

|

