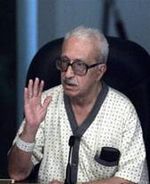|
|
Irak
Tarek Aziz, l'homme
qui en sait trop
Gilles Munier
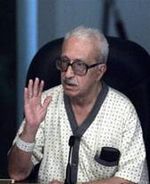
Juin 2008
Tarek Aziz - huit de pique du jeu de cartes du Pentagone - est
la personnalité irakienne la plus connue, avec Saddam Hussein.
Il est né en 1936 à Tel Keyf, près de Mossoul, dans une famille
chrétienne chaldéenne. Peu pratiquant, il se considère comme
Arabe avant tout, son prénom ayant été choisi en mémoire de
Tariq Ibn Ziad, conquérant de l’Andalousie au 8ème siècle.
Un nationaliste arabe de la génération 58
Lecteur dans sa jeunesse d’Hegel, de Marx et de Nietzsche, féru
d’histoire arabe, il a adhéré tôt au parti Baas. Fidèle au
courant originel dirigé par Michel Aflak, il a été emprisonné un
an en Syrie, en 1966, après le coup d’Etat d’Hafez al-Assad.
Après la Révolution baasiste en Irak de 1968, il a été directeur
d’Al-Thawra - quotidien du parti - ministre de l’Information et
de la Culture, des Affaires étrangères, et vice-Premier ministre
à deux reprises. Il est membre du Commandement régional
(irakien) du parti depuis 1974, et du Conseil de Commandement de
la Révolution depuis 1977.
Le 1er avril 1980, il a été blessé lors d’un attentat faisant
plusieurs morts à l’Université Moustansirya de Bagdad. Les
terroristes d’Al-Dawa, basé à Téhéran, voyait déjà en lui un de
ses principaux ennemis.
Tarek Aziz est un des plus grands diplomates arabes
contemporains. Il a été de tous les combats : pour la libération
de la Palestine, contre l’apartheid et l’impérialisme américain
dans le Tiers monde. Les Anglo-saxons lui reprochent d’être un
des artisans de la « politique française de l’Irak ». Il a
présidé la Conférence de Bagdad qui réunissait tous les 6 mois
plusieurs centaines de partis et d’organisations luttant pour la
levée de l’embargo.
Les Américains ne veulent pas que Tarek Aziz parle des relations
irako-américaines sous Reagan et au début du mandat de Bush
père. Les Iraniens et leurs alliés miliciens se vengent d’un
baasiste emblématique et d’un chrétien indocile
Le 29 avril dernier, dans le box du Haut tribunal pénal de la
Zone verte, le vice-Premier ministre irakien Tarek Aziz est
apparu fatigué, malade, amaigri par 5 ans d’incarcération au
Camp Cropper, près de l’aéroport de Bagdad . Le juge kurde Raouf
Abdel Rahmane, connu pour avoir condamné à mort Saddam Hussein,
l’accuse d’avoir participé, en 1992, à la décision d’exécuter 42
grossistes qui spéculaient sur le prix des denrées alimentaires.
Ceux qui sont allé à Bagdad cette année là savent dans quelle
situation dramatique se débattaient les Irakiens. En raison de
l’embargo, le dollar dépassait les 3000 dinars, alors qu’en 1990
il en fallait trois pour avoir un dinar. Les denrées
alimentaires et les médicaments manquaient ou étaient hors de
prix.
Cela dit - et quelle que soit l’opinion portée sur la rigueur de
la justice irakienne en temps de guerre - il faut préciser que
Tarek Aziz ne s’occupait ni des questions de sécurité, ni du
commerce. De plus, il n’a pas participé - selon son fils Ziad,
réfugié en Jordanie - à la réunion du Conseil de Commandement de
la Révolution – organe suprême du pays, dont il était membre -
qui a étudié le dossier des grossistes. Le vice-Premier ministre
avait en charge les relations internationales et la levée du
blocus. Les accusations portées aujourd’hui contre lui ne sont
pas crédibles. Personne n’a d’ailleurs jamais déposé de plainte
contre lui. Tarek Aziz, dit-on en Irak, « n’a pas de sang sur
les mains ».
Incarcéré dans la « cellule des chiens »
Depuis sa reddition, en avril 2003, son dossier en justice était
vide. Il n’était accusé de crime, périodiquement, que lorsqu’il
était question de le libérer pour raisons de santé. Le régime de
Bagdad, s’y refusant obstinément, l’a ainsi accusé d’avoir
participé à la condamnation à mort, en avril 1980, de
l’Ayatollah Muhammad Baqer al-Sadr, fondateur d’Al-Dawa, puis à
la répression de complots internes au parti Baas dans les années
70 et 80, et enfin à celle du soulèvement sudiste de 1991, après
la première guerre du Golfe.
Les Américains, véritables organisateurs des procès de Bagdad,
ne lui pardonnent pas d’avoir refusé de témoigner contre Saddam
Hussein - y compris en échange de sa libération - et son
intervention en faveur du Président irakien et des autres
accusés au procès.
Washington craint aussi les révélations qu’il pourrait faire sur
les dessous de la politique moyen-orientale américaine du temps
de Reagan et au début du mandat de Bush père. Il peut évoquer le
scandale étouffé de la BCCI, ou l’Iraqgate avec le détournement
de subventions agricoles pour vendre des produits chimiques à
double emploi, ou encore le versement de commissions aux partis
Républicain et Démocrate lors d’achats massifs de blé ! Les
Iraniens et Al-Dawa se vengent d’un baasiste emblématique et
d’un chrétien indocile. Abdul-Aziz Al-Hakim, chef du Conseil
suprême de la révolution islamique en Irak, a déclaré que la
présence de chiites parmi les commerçants exécutés aggravait son
cas.
Au Camp Cropper, au début de sa détention, Tarek Aziz était
enfermé dans une pièce d’un mètre sur deux, appelée « « cellule
des chiens », réservée jadis à ceux des services de sécurité de
l’aéroport. Malgré ses problèmes cardiaques – il a été
hospitalisé d’urgence deux fois - malgré les interrogatoires
ponctués d’insultes et de menaces, il n’a pas craqué. En 2005,
trompant l’attention de ses gardiens, il a griffonné un appel
sur le carnet de Badie Aref, son avocat irakien. Il demandait à
l’opinion publique internationale un « traitement équitable, un
procès équitable précédé d’un enquête équitable ». Depuis, son
avocat a été menacé de mort et s’est réfugié à Amman. Les
Américains l’ont informé qu’ils n’assuraient plus sa sécurité et
un juge a lancé un mandat d’arrêt contre lui, sous prétexte
qu’il ne partage pas son avis sur le soulèvement sudiste de
1991.
« Que sont mes amis devenus ? »
L’annonce du procès de Tarek Aziz n’a pas encore soulevé de
protestations d’importance au niveau mondial, ni ému,
semble-t-il, les personnalités qui faisaient des pieds et des
mains pour entrer dans son bureau à Bagdad ou pour le rencontrer
lors de ses déplacements à l’étranger. A Paris, sa suite à
l’hôtel Meurice ne désemplissait pas de solliciteurs, toutes
tendances confondues.
Nicolas Sarkozy, interrogé en janvier 1995 sur la visite à Paris
de Tarek Aziz – c'est-à-dire après les faits qui lui sont
aujourd’hui reprochés – avait déclaré que la France avait le
droit « de recevoir qui elle veut, quand elle veut ». Lionel
Jospin, Alain Juppé, Charles Pasqua, l’avaient reçu. Il s’était
même entretenu discrètement avec le Président Chirac. Que sont
tous ses amis devenus ?
L’appel lancé en mai 2003 pour la libération de Tarek Aziz par
les Amitiés franco-irakiennes, relancé en 2005 par le
parlementaire britannique George Galloway a certes réuni plus de
250 signatures - notamment celles de Jean-Pierre Chevènement et
du Président Ahmed Ben Bella – mais il est demeuré sans effet.
Un Comité de défense de Tarek Aziz et des prisonniers politiques
irakiens a été créé fin avril dernier, sans trop d’illusions sur
l’attitude que vont adopter ses « amis » politiques français.
Certains - comme Roselyne Bachelot qui présidait le Groupe
d’Etudes France-Irak à l’Assemblée nationale - sont aujourd’hui
au pouvoir… et bien silencieux.
La France se tait
La défense de Tarek Aziz, au niveau international, est assurée
par Jacques Vergès. L’avocat a demandé un visa pour s’entretenir
avec son client. Il veut faire le procès de l’invasion et de ses
crimes. Il mettra en cause la légalité du Haut tribunal spécial,
notamment au regard des conventions internationales sur le
traitement des prisonniers de guerre. On comprend pourquoi les
autorités de la Zone verte – comme on dit à Bagdad – font la
sourde oreille à sa demande.
Quelle que soit la réponse américaine, se posent déjà des
problèmes de sécurité. Au procès de Saddam, des avocats ont été
menacés. L’un d’eux a été assassiné. Des témoins de la défense,
effrayés, ont refusé de comparaître. La France qui a voté, le 16
octobre 2003, la résolution 1511 du Conseil de sécurité
avalisant l’occupation de l’Irak, a plus qu’un mot à dire sur ce
qui s’y passe depuis. Elle doit veiller, entre autre, au bon
déroulement du procès de Tarek Aziz. Le silence du Quai d’Orsay,
en la circonstance, signifierait complicité.
Source: Afrique Asie – juin 2008
 |