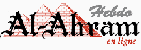|
George W. Bush. Le président Bush a adopté une politique très agressive vis-à-vis du monde arabe qui s’explique en grande partie par des convictions personnelles selon de nombreux analystes.
Mercredi 9 janvier 2008 « Ce qui est certain, c’est que George Bush aura été le pire président américain depuis la seconde guerre mondiale, tant pour la planète que pour les Etats-Unis eux-mêmes », le jugement est de Pascal Boniface, directeur de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), à Paris. Il l’a confié à Media France Internationale (MFI). Et c’est en grande partie par la politique arabe du locataire de la Maison Blanche que s’explique cet échec : « La guerre en Iraq a été une erreur majeure, et une faillite morale et stratégique. Le fait de concevoir les relations internationales comme une croisade, de les réduire à un affrontement entre eux et nous (ndlr : l’Occident), entre le bien et le mal, ne constitue pas un progrès, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan stratégique », affirme Boniface. Cette évaluation faite, alors que le chef de l’exécutif est à sa dernière année de présidence fait poser une question. S’agit-il du tempérament, du caractère et des croyances personnelles de Bush ou de toute une lignée ou composante américaine ? De nombreux observateurs mettent en avant et sa doctrine néo-conservatrice et religieuse et son origine de capitaliste local aux idées fermées. Mohamad Al-Sayed Saïd, politologue et rédacteur en chef du quotidien égyptien indépendant Al-Badil, estime que pour l’exemple le plus patent de l’échec du président, celui de l’invasion de l’Iraq, « il s’agit en grande partie d’un rôle personnel et non de celui de l’establishment militaire. Avant l’invasion de l’Iraq, le Pentagone et d’anciens généraux ont laissé filtrer des informations sur ces projets militaires afin de tenter d’éviter la guerre. Ils ont mené une importante campagne médiatique à ce sujet », explique-t-il. Bush évidemment n’en a pas pris compte comme il l’a fait avec l’Onu, et une grande partie de la communauté internationale et même les alliés arabes traditionnels des Etats-Unis qui, depuis, sont dans un état de confusion extraordinaire. Sans tenter de faire la psychanalyse de Bush, son passé incite le politologue à relever une vision acquise au départ qui l’a poussé à une politique aussi belliqueuse. « C’est sa personnalité de body guard du capitalisme local, c’est-à-dire limité à une région donnée, qui serait à la base de cette dérive guerrière. Il fait partie de ces Blancs à la culture limitée, mus par une tendance au fanatisme, une fidélité ethnique, une disposition à la violence et au racisme en faveur des Blancs. Sa doctrine politique est celle du WASP (White Anglo-Saxon Protestant) ». Mohamad Al-Sayed Saïd se réfère aussi à la carrière dans l’industrie du pétrole de Bush qui a commencé en 1978 avec la création d’Arbusto Energy (arbusto signifie Bush en espagnol), une entreprise de recherche de pétrole et de gaz. Un aspect fondamental de cette dérive politique de Bush est ses convictions de néo-fondamentaliste investi d’une mission quasi divine pour rétablir l’ordre et la moralité dans le monde et le Proche-Orient, surtout. Il est un Born Again Christian, c’est-à-dire un chrétien qui est « né de nouveau ». Il a imprimé cette foi au cœur du travail gouvernemental. Les réunions du gouvernement à la Maison Blanche commenceraient par une prière et la lecture d’un passage de la Bible, relèvent les différentes études faites à ce sujet. Comme le souligne Mohamad Al-Sayed Saïd, c’est Ronald Reagan qui a commencé au sein du Parti républicain à se servir des arguments religieux pour diaboliser l’Union soviétique. Aujourd’hui, la rhétorique est restée la même, mais l’ennemi a changé : ce n’est plus le communisme, c’est l’islam avec comme objectif la nécessité de protéger « Israël donné aux juifs par Dieu ». Autant de notions qui ont contribué à façonner la politique de Bush. Mohamad Al-Sayed Saïd relève cependant qu’il y a de la simulation à ce sujet. « Le lien avec la religion est de caractère opportuniste et politique. Il n’y a pas chez lui de vrais sentiments religieux, ni même une assimilation réelle de l’enseignement religieux. Il s’est attaché à la religion en tant qu’idéologie politique en concordance et en coordination avec des mouvements religieux et non des églises, ce qu’on appelle Moral Majority ». Il reste que, pour cette dernière année au pouvoir, George Bush s’attelle au dossier palestino-israélien. Paradoxal ? Il reste que le moins que l’on puisse dire est que Bush est pour notre région l’Américain le moins populaire.
Droits de reproduction et de
diffusion réservés. © AL-AHRAM
Hebdo |
|
|
Source : Al-Ahram hebdo http://hebdo.ahram.org.eg/... |
Avertissement
Palestine - Solidarité a pour vocation la diffusion
d'informations relatives aux événements du Moyen-Orient et de
l'Amérique latine.
L' auteur du site travaille à la plus grande objectivité et au respect des opinions
de chacun, soucieux de corriger les erreurs qui lui seraient signalées.
Les opinions exprimées dans les articles n'engagent que la responsabilité
de leur auteur et/ou de leur traducteur. En aucun cas Palestine -
Solidarité ne saurait être
tenue responsable des propos tenus dans les analyses, témoignages et
messages postés par des tierces personnes.
D'autre part, beaucoup d'informations émanant de sources externes, ou
faisant lien vers des sites dont elle n'a pas la gestion, Palestine -
Solidarité n'assume
aucunement la responsabilité quant à l'information contenue dans ces
sites.
Pour
contacter le webmaster, cliquez <
ici >